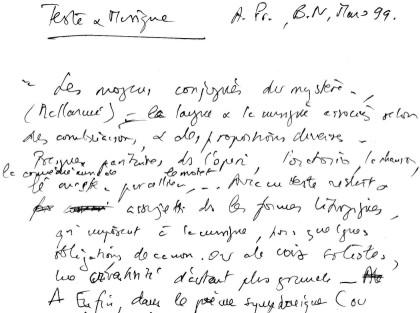
Annie Prassoloff nous a quittés le 1er avril 1999. Nous avons transcrit ici les notes, en grande partie rédigées, qu'elle destinait à un article sur Texte et Musique .
TEXTE ET MUSIQUE
(Inédit)
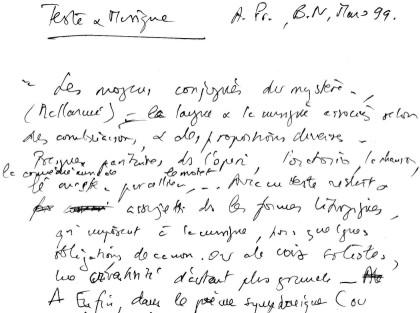
Annie Prassoloff nous a quittés le 1er avril 1999. Nous avons transcrit
ici les notes, en grande partie rédigées, qu'elle destinait à
un article sur Texte et Musique .
Interrogeons-nous sur "les moyens conjugués du mystère"
(Mallarmé) : la langue et la musique, associées selon des combinaisons
et des proportions diverses. Presque paritaires dans l'opéra, l'oratorio,
le motet, la chanson ou la comédie musicale, elles apparaissent avec
un texte réduit et assujetti dans les formes liturgiques, qui imposent
à la musique, hors quelques obligations de canon ou de voix solistes,
une créativité d'autant plus grande. Enfin, dans le poème
symphonique (ou le ballet), nous constatons la totale ou partielle "disparition
élocutoire" du texte, absorbé dans le gestuel et le musical,
que toutefois il anime et habite, comme un fantôme subtil ou caricatural,
n'apposant sa signature qu'en des endroits consacrés : le titre au seuil
de l'œuvre, ou la littérature parallèle -programme, commentaire-,
dont Françoise Escal a fait de fines analyses (Aléas de l'œuvre
musicale , Paris, Hermann, 1997). Erik Satie, quant à lui, développe
des versions parodiques, en faisant courir sous ses préludes des phylactères
de textes plus ou moins facétieux, ou décalés, avec des
titres de même farine : "La Journée d'un bureaucrate",
"Pensées d'un chien", etc.
La marque de l'esthétique expressive et madrigalesque du début
du XVIe siècle a renforcé et armé de théorie la
tendance spontanée, mais non universelle, à faire que la musique
soit, comme y tendit Purcell, "la forme exaltée de la parole".
Mais cette relation de ressemblance, de redoublement, a pris des formes historiquement
variables et diversement codées. La plus caractéristique fut peut-être
le système figuraliste minutieux - vivant pendant toute la période
baroque-, qui consiste à affecter à chaque mot une "figure"
musicale descriptive, vraie "banque de données" générales
dans lesquelles chaque musicien puise en toute bonne conscience, avec une application
artisanale et sans scrupule moderne d'originalité. Ainsi l'entrée
du chœur (donc de tous!) sur le mot "omnes", les classiques descentes
sur les mots "bas", "profond", creux", "tombe",
les montées et les aigus sur "haut", "ciel", "élevé",
"dressé", etc.
La communauté de dictionnaire n'empêche pas d'ailleurs une invention
singulière, comme ce très physiologique tressaillement de Jean-Baptiste
encore à naître, marqué par un sursaut instrumental, dans
une cantate de Bach. Ou bien la description d'une opération de la pierre,
au clavecin et à la viole, par Marin Marais, avec le tableau de l'appareil,
les liens imposés au patient, son tremblement, son évanouissement
puis sa douce résurrection. Mais les décrypteurs modernes de ces
dialectes musicaux, le grand André Pirro en 1906 sur Bach, plus tard
Jacques Chailley reprenant sous le même éclairage la lecture des
Passions , ont soulevé un tollé chez les fervents de l'inspiration,
et plus superstitieusement, dans ce cas, les croyants en un Dieu-le-Père
de la musique, recevant directement ses messages du Dieu-le-Père qui
l'a précédé aux cieux. Comme si la naïveté
apparente du procédé excluait l'apport capital de la syntaxe qui
lie ces vocables, et la grandeur dans leur traitement. Reconnaissons que la
possibilité d'entendre ces effets (sans excès de morcellement)
dans une exécution minutieuse et colorée est l'un des nombreux
apports des "baroqueux" à notre écoute : elle donne
chair et vie à ce qui pouvait sembler, sur le papier, une combinatoire
limitée et quelque peu stérile.
Les figuralismes n'ont pas disparu de la musique romantique, ni même post-romantique
(Debussy), mais ils se sont élargis dans un traitement plus ouvert des
affects, avec des intonations plus sciemment personnelles, ou au contraire un
sacrifice (non obligatoire) du sens aux effets phonétiques. Pensons par
exemple, chez le même Debussy, au "a" prolongé de "Sirènes"
qui, par sa simple vibration, devient, selon la formule de Nicolas Ruwet, "le
signifiant pur de la séduction". D'autre part, et même dans
les périodes les plus portées à une esthétique de
la traduction du verbe en musique, les effets les plus intéressants,
quelquefois, pour l'oreille et pour l'analyse, sont obtenus grâce à
des interrogations et à des décalages, à des démentis
apportés au sens premier du texte, par l'orchestre ou la ligne vocale.
La formule, banale en soi, d'une musique proférant l'inconscient du texte
(ou des personnages dans un opéra), prend là un sens vérifiable.
Yseult proclamant sa haine pour Tristan tandis que l'orchestre joue le thème
de son futur amant, c'est l'annonce d'un avenir et, déjà, d'une
ambiguïté dont sa parole n'est pas maîtresse. Mélisande,
sous le feu des questions de Golaud, s'écriant : "Non, non, ce n'est
pas Pelléas, ce n'est pas lui... c'est quelque chose qui est plus fort
que moi", entend-elle ce que nous entendons, le mariage de son thème
avec celui du jeune frère qu'elle s'efforce de fuir? Il est bien simpliste,
ou bien misogyne, de s'imaginer qu'elle "ment" délibérément.
Cette révélation par la musique semble fournir une explication
plus cohérente (malgré le, plus tardif, "je ne mens qu'à
ton frère").
Cette esthétique de la traduction n'empêche pas l'exercice des
capacités polyphoniques de la combinatoire lyrique ; "polyphonie"
est à comprendre ici dans un sens plus large que le strict sens technique
(l'étagement des lignes mélodiques, d'orchestre ou de voix, en
des combinaisons verticales simultanées). Le système des ensembles
de voix dans l'opéra ou la cantate permet d'étager les discours
en leur laissant, grâce à la différence des hauteurs et
des tessitures, une certaine intelligibilité. Elle dépend aussi
de l'adresse du compositeur. On a objecté que la musique n'avait pas
le monopole de cette possibilité. Mais les exemples allégués
au théâtre sont tout de même beaucoup plus rares : les voix
réellement étagées dans Peer Gynt sont traitées
quasi musicalement, et la plupart des autres exemples de paroles simultanées,
sauf les effets limités d'a parte, tournent à la cacophonie, ou
encore la recherchent volontairement, dans un but comique ou descriptif (Figaro).
Quelle éloquence de la forme, au contraire, dans ce trio d'Acis et Galathée
de Haendel, où l'orchestre, par une ritournelle étrangement rustique,
précède le duo des amants enfin unis (mais l'on comprendra que
cette rusticité un peu lourde, cette marche appuyée du basson
et du hautbois, est prophétique). Le duo en fugue procure le moment élégiaque
attendu, mais permet aussi, par sa lisibilité formelle, de laisser une
partie de l'attention disponible pour le discours de l'orchestre. Et pour l'intervention
à peine chantée, plutôt parlée, du jaloux Polyphème,
donnant à la fugue aérienne la basse bien terrestre qui à
la fois la soutient et la menace. Rapprochée, amplifiée, la voix
de Polyphème, crescendo , prend le premier rôle, rejoignant l'orchestre
annonciateur, jusqu'au meurtre du malheureux berger (traduit musicalement par
la survie désolée des cordes, après que sa voix se soit
tue brusquement).
Plus connues sans doute sont les belles horlogeries mozartiennes, comme cette
fin de l'acte II des Noces de Figaro , avec son trio devenant quatuor, quintette,
sextuor, septuor. Là aussi, à l'habileté artisanale de
l'étagement des voix, s'ajoute une sémantique propre de la forme.
Le Comte, d'abord en surplomb, vocal et social ("Io son qui per giudicar")
au-dessus de la mêlée des deux groupes, finit par rejoindre musicalement
le côté vers lequel il penche, celui des opposants au mariage de
Figaro, trahissant ainsi sa position véritable, cependant que la voix
subtile de Suzanne, d'abord fondue dans un trio désolé avec la
Comtesse et Figaro, émerge en volutes inquiètes, mais gracieuses,
qui annoncent son rôle croissant dans l'opéra et la "promotion"
psychologique et esthétique que représente pour une suivante,
l'air suave de la scène du bosquet " ("Deh! vieni, non tardar,
o gioia bella").
Cette mise en question psychologique du texte par la musique s'élargit
en une interrogation sur le langage lui-même dans le Moïse et Aaron
de Schönberg, où s'opposent deux philosophies du langage : celle
de l'intériorité réservée, économe et résignée
à l'insuffisance de toute transmission de l'expérience religieuse
(Moïse), et celle d'une communication séductrice, manipulatrice
(Aaron), apte à utiliser aussi bien la démagogie verbale que les
charmes d'un lyrisme musical entêtant, qui suspend la pensée. De
façon voisine, dans sa pièce lyrique Apès une lecture d'Orwell
, Mauricio Kagel invente une langue du pouvoir qui juxtapose des termes nobles
et des cris et phonèmes démembrés, répétés
jusqu'à la transe, sur un fond orchestral lancinant complété
de bruits de bottes et de mécanismes d'horloge obsédants. Là
aussi, et contrairement à certains poncifs, la musique révèle
tandis que le texte endort, anesthésie le réflexe critique.
Mais en dépassant ces emplois politiques ou dramatiques, de telles combinaisons,
de telles inversions d'effet renvoient à une question plus générale,
posée par Nietzsche et reprise par de modernes sémioticiens de
la musique (comme Ivanka Stoianova) : ne conviendrait-il pas, y compris dans
la poésie, ou même le roman -Joyce, Beckett-, de remusicaliser
la langue, plutôt que d'appliquer à la musique des schémas
de signification de style langagier ? L'élément gestuel, chorégraphique,
de la parole, "l'inanité sonore" a bien pu être proscrite
par les classiques, mais elle est revendiquée par les mélomanes
du langage.
Dans un texte très discuté des années soixante-dix, Roland
Barthes opposait à un "art expressif, dramatique, sentimentalement
clair", celui qui laisse percevoir le "grain de la voix, lorsque celle-ci
est en double posture, en double production : de langage et de musique",
lorsqu'elle se consacre, non à découper et souligner des affects
reconnus et identifiables, mais à installer entre le chanteur et l'auditeur
une souterraine et infinie vibration de "la matérialité du
corps parlant sa langue maternelle", créant ainsi un "espace
où les significations germent du dedans de la langue et dans sa matérialité
même." Mérite reconu à l'art de Panzera qui, sans nuire
à l'intelligibilité, savait "patiner" les consonnes
que l'on "emphatise" souvent "pour satisfaire à la clarté
du sens", "leur rendre l'usure d'une langue qui vit, fonctionne et
travaille depuis très longtemps", "en faire le simple tremplin
de la voyelle admirable".
Sans aller jusqu'au bout de cette logique, c'est bien cet envers de la langue
qu'éclairait d'ailleurs le travail conjoint des librettistes et des musiciens
choisissant dans un texte les sons les plus vibrants (les voyelles à
vocaliser), ou les plus expressifs (le "l" chargé d'un désir
inconsolable de la Lady Macbeth de Verdi : "La luce langue"). L'impressionnant
travail accompli par Verdi pour donner, sur la même musique, les deux
versions, française et italienne, de son Don Carlos est, en même
temps qu'un tour de force technique, une exploration du génie des deux
langues, de leurs vertus et de leurs limites. Le français donne au grand
air de Philippe II une sorte de nudité aggravée par la gaucherie
de l'accentuation : "Elle ne m'aime pas...", alors que l'italien magnifie
le lyrisme désolé de l'aveu en mettant au premier plan le maître
mot et ses voyelles pleines : "Amor per me non ha".
Éluard, sans renoncer au "message", en restitue le mérite à Poulenc qui l'a mis en musique :
"Francis je ne m'écoutais pas
Francis, je te dois de m'entendre".
Annie Prassoloff - Mars 1999